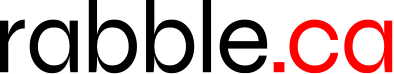par Pierre Beaudet avec Francois Cyr*
La crise actuelle est mondiale même si elle est «visible» surtout aux États-Unis. De par la mondialisation des marchés, elle risque de «contaminer» les principaux pays capitalistes en Europe, au Japon et au Canada. Mais les impacts de cette crise seront sans doute plus dramatiques là où des centaines de millions d’humains sont déjà enfoncés dans une profonde crise qui les menace même dans leur existence. Ainsi depuis quelques mois, 300 millions de personnes de plus sont frappées par la famine dans le sillon des augmentations de prix des denrées alimentaires. On voit donc que la crise actuelle n’est pas seulement unidimensionnelle, liée aux spéculations bancaires et hypothécaires de Wall Street. En fait, il serait plus juste de parler d’une crise «globale», qui risque de précipiter le monde dans une vaste régression. À moins que …
Retour en arrière
Certes, la crise actuelle n’est pas la première dans l’histoire du capitalisme. Régulièrement, «cycliquement» disent les experts, la compétition, la course aux profits, l’exploitation des personnes et des ressources, inhérentes au capitalisme, produisent des impasses. Pendant de longues périodes de temps, ce qui avait été construit est défait. Les citoyens, les gouvernements, les entreprises ne sont plus solvables. Les plus gros mangent les gros qui mangent les moyens qui mangent les petits. Au vingtième siècle, tout cela a débouché sur la grande crise des années 1930. Face à cela, les dominants ont répondu par la violence, dont la conquête du tiers-monde et la guerre entre les principales puissances. Autrement, les dominés ont résisté et imposé, avec des luttes immenses, aux élites un compromis qui a conduit à la défaite du fascisme et au «grand compromis» qu’on a appelé le keynésianisme. Après des décennies de crise donc, le monde est ressorti de la noirceur: c’est ce qu’on appelé les «trente glorieuses» (1945-75), pendant lesquelles beaucoup de gens (pas tous) ont connu une amélioration de leurs conditions de vie dans une relative stabilité sociale.
L’érosion
Mais comme cela est toujours le cas, le capitalisme porte des contradictions qu’il ne peut dépasser. Menacées de mort si elles n’augmentent pas leurs profits, les entreprises doivent réduire leurs coûts et augmenter le taux d’exploitation. Au tournant des années 1970-80, elles ont cherché à réduire les coûts salariaux par une première phase de «mondialisation». Avec l’administration Reagan aux États-Unis, c’est le retour à la «normale», c’est-à-dire, au capitalisme «dur et pur». Ainsi, les attaques contre les droits acquis, le retour de la guerre froide, les privatisations tout azimut ont peu à peu remplacé le keynésianisme par le néolibéralisme, une nouvelle façon de réguler l’accumulation du capital. Les salaires ont baissé, les conditions de travail se sont détériorées et les grandes entreprises ont accéléré leur «cannibalisation» des petites et moyennes entreprises. Face au tiers-monde, cette politique a eu des effets dévastateurs dans le contexte d’États fragiles et soumis aux prescriptions très dures de la Banque mondiale et du FMI.
Triomphe apparent
Au début des années 1990, la guerre froide a pris fin permettant aux intellectuels de service de proclamer la victoire définitive du capitalisme. Washington a alors changé sa politique étrangère pour amorcer une nouvelle conquête du monde (sous Bush papa et Clinton). Le néolibéralisme s’est transformé en une gigantesque avancée des secteurs financiers, au détriment de l’économie réelle. Banquiers, boursicotiers, vulgaires criminels en cols blancs se sont lancés dans une série d’opérations spéculatives, créant ainsi la série de bulles qu’on a vues défiler depuis 15 ans. La bulle «techno», la bulle «bancaire», la bulle «énergétique», la bulle «des ressources» sont en fait la même et unique bulle qui représente les efforts des institutions financières, aujourd’hui dominantes, de jouer dans une sorte d’économie-casino déconnectée du monde de la production. Pour faciliter cela, les gouvernements des principaux pays capitalistes ont «libéré» ces institutions de tout contrôle, et ont même encouragé les classes populaires et moyennes de participer au «casino» en question. Tout au long des années 1990, les bulles ont éclaté à plusieurs reprises, surtout dans des États fragiles, en Amérique latine, en Asie, en Russie. Les signes avant-coureurs étaient là et bien des économistes le disaient et le répétaient, «ça va exploser».
Le règne des voyous
Au début des années 2000, l’économie américaine démontrait déjà de sérieux signes d’épuisement. Au lieu de confronter les problèmes, Bush junior et son ineffable adjoint Dick Cheney ont préféré la fuite en avant, profitant, si on peut dire, des évènements du 11 septembre 2001. On a alors assisté alors à une véritable frénésie du côté des marchés financiers. Manipulant ces évènements, les politiques ont été gelé autour de la de la militarisation du système mondial et de la reconquête du Moyen-Orient. Entre-temps, de véritables prédateurs ont accéléré leurs manœuvres empochant des milliards encore là sur la spéculation et la manipulation des marchés. Parallèlement, les États-Unis enregistraient les plus formidables déficits de son histoire. Le néolibéralisme est devenu néoconservatisme, dans un mélange terrible d’attaques contre les droits sociaux et économiques, de moralisme réactionnaire et de violences contre les classes populaires.
Une construction et non une fatalité
Les crises économiques ne sont jamais qu’économiques. Leurs conclusions reposent en dernière analyse sur les rapports de forces sociaux et politique. Le grand virage amorcé depuis les années 1980 a été le résultat d’une offensive des dominants, et non comme la propagande le proclame, le «triomphe du marché» et de la «main invisible». Aujourd’hui que le projet néolibéral et néoconservateur est sur la brèche, on constate le retour en force de certaines des prescriptions keynésiennes. Pour éviter le crash des bourses et des banques, Washington se retrouve en fait à imposer l’État au centre du système financier, alors que la «religion» du néolibéralisme de Milton Friedman apparaît comme totalement inopérante. Bien sûr, Bush cherche à socialiser les pertes, après avoir pendant des années privatisé les profits. D’où le mécontentement évident des classes populaires. «Ils nous font payer leurs crises».
Pompiers-pyromanes
Maintenant que la maison est en feu, les dominants, tels des pompiers-pyromanes, nous disent qu’il faut calmer le jeu. Le plus cynique est probablement Stephen Harper qui nous dit que tout va bien, au moment où des centaines de milliers d’emplois s’envolent en fumée et que la crevaison de la dernière bulle (celles des ressources) frappe de plein fouet la bourse de Toronto tout en menaçant sérieusement les épargnes durement mises de côté par les classes moyennes et populaires sous forme de REER. Le pire est que de manière générale, ce discours d’éteignoir est repris par l’essentiel des médias, des partis politiques et des élites intellectuelles qui refusent de remettre en question un système prédateur, générateur de crises dont les victimes ne sont jamais ceux qui les ont provoqués. Le «sauvetage» de Wall Street s’inscrit totalement dans cette approche. Dans le cadre de la présente campagne électorale canadienne, les deux principaux partis, Conservateur et Libéral, s’alignent sur ce même registre, bien que Harper s’enfonce dans le déni («la crise ne menace pas le Canada»).
Néokeynésianisme ?
Récemment, des voix dissidentes se sont toutefois élevées aux États-Unis. Les mouvements sociaux et quelques personnalités politiques comme le sénateur Bernard Sanders proposent de renationaliser les institutions financières, et non de les recapitaliser en leur laissant toute la marge de manœuvre. Il faut également mettre fin à la domination de la financiarisation, casser l’économie-casino en quelque sorte, et remettre les capitaux, sous le contrôle de l’état, au service de l’économie réelle. Par exemple, au lieu d’exporter les capitaux vers les zones de bas salaire et réimporter les produits dans le «système Wal-Mart», il faut dynamiser l’économie locale, réguler (à la hausse) les salaires, investir dans les infrastructures déficientes, revamper l’éducation et la santé. C’est en partie ce que disent ici le NPD et le Bloc québécois, mais on a l’impression que leurs propositions restent très modérées. Évidemment, le rapport de forces semble très inégal. Les dominants restent arrogants, confiants de pouvoir s’en sortir avec de nouveaux «spins».
Mais l’histoire pourrait se répéter. En fait devant nous se posent deux grandes options. Ou bien les dominants vont rester sur leurs positions, probablement en amenant le monde vers la confrontation, voire la guerre, de façon à forcer les dominés à accepter l’inacceptable. Ce serait en tout cas l’option de McCain et de Harper. Ou bien les dominés vont s’imposer, comme ils le font d’ailleurs en Amérique latine, pour imposer un nouveau «new deal». En tout cas, cette deuxième option ne viendra pas «magiquement». Elle va nécessiter une très dure et une très longue lutte.
* Ancien président de l’Union des forces progressistes, Francois Cyr est avocat en droit social et a tour à tour été président du syndicat des chargés de cours de l’Université de Montréal et vice-président de la FNEEQ-CSN.